- Maladie neurodégénérative: la Révolution est en marche
Que ce soit sur le plan diagnostique, que thérapeutique, le fatalisme dictant que le vieillissement est associé à un déclin inexorable des capacités cognitives et motrices n’ est plus de mise. Le discours doit changer aussi bien dans la communauté médicale que plus largement dans la société. Cette mutation ne se fait toutefois pas sans résistance: on observe toujours chez certains patients, leur proche, ainsi que chez certains confrères une retenue à considérer une évaluation des troubles cognitifs chez les patients âgés, si bien qu’ aujourd’ hui on estime que seulement 50 % des patients avec troubles cognitifs bénéficient d’ une évaluation spécialisée, avec, pour l’ exemple du canton de Vaud, environ la moitié de ces 50 % évaluée dans l’ un des quatre centres mémoires du canton. Ceci est d’ autant plus regrettable, que le réseau des Centres Mémoires de Suisse Romande est particulièrement bien organisé et structuré au sein d’ un réseau romand unique – ROMENS – permettant à la population romande d’ avoir accès à une plateforme multidisciplinaire leur offrant un accès aux nouveautés diagnostiques et thérapeutiques. Ce réseau permet également de maintenir un niveau de connaissance élevé au sein de toute la Romandie, par le recours à des formations structurées, comme le Cours lémanique des démences.
L’ arsenal diagnostique est arrivé à une maturation telle qu’ aujourd’ hui, il est possible d’ identifier la neuropathologie de la maladie d’ Alzheimer avant même l’ arrivée des premiers symptômes. Cela peut se faire par le recours à des biomarqueurs biologiques dans le liquide céphalo-rachidien ou par des techniques d’ imagerie métabolique permettant de visualiser les anomalies biologiques que sont le dépôt de protéines tau ou amyloïde directement à l’ aide d’ un scanner. Dans la pratique clinique, nous n’ avons recours à ces techniques diagnostiques que chez les patients symptomatiques.
L’ autre pan de la révolution concerne l’ axe thérapeutique avec l’ arrivée d’ immunothérapie pour la maladie d’ Alzheimer. Désormais, les autorités sanitaires de nombreux pays (USA, Angleterre, Chine ou Israël) ont donné leur accord pour l’ utilisation d’ anticorps ciblant l’ amyloïde dans le cadre de la maladie d’ Alzheimer. Ces nouveaux traitements sont toutefois associés à des effets secondaires préoccupants, se traduisant par des hémorragies et des œdèmes cérébraux, particulièrement prévalant chez certains sous-types de patients.
Cette révolution thérapeutique, que l’ on vit dans le cadre de la maladie d’ Alzheimer, et son application par les autorités de santé est en train de créer une inéquité de traitement à travers le monde et nécessite une prise de conscience sociétale, afin de ne pas laisser de côté des patients souffrant d’ une maladie inéluctable. Le 9 octobre 2024, le Centre Leenaards de la Mémoire a réuni des experts internationaux pour stimuler une réflexion intégrant les dimensions éthiques, économiques, médicales et biologiques en lien avec l’ arrivée de ces traitements pour la maladie d’ Alzheimer. Ce que l’ on vit dans le cadre de la maladie d’ Alzheimer va s’ étendre à d’ autres pathologies neurodégénératives, si bien que nous devons d’ ores et déjà nous préparer à accueillir cette nouvelle technologie, qui contribuera à améliorer la qualité de vie de nos patients, à condition bien entendu que notre société soit prête à faire évoluer le paradigme que le vieillissement est associé à un déclin inéluctable des capacités cognitive et motrice.
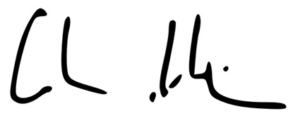
Pr Gilles Allali
Centre Leenaards de la mémoire
Département des neurosciences cliniques,
CHUV et UNIL
Chemin de Mont-Paisible 16
1011 Lausanne






