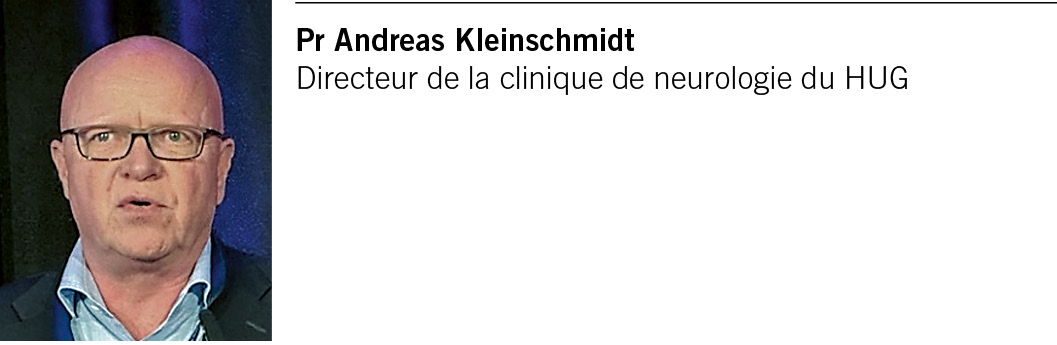- Mise à jour sur la migraine et les céphalées
Lors de l’assemblée de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne Générale de cette année (SSMIG) à Bâle, le Pr Andreas Kleinschmidt a donné un aperçu des derniers développements dans le domaine de la migraine et des céphalées. Les connaissances dans ce domaine ont connu un développement remarquable ces dernières années.
Une meilleure compréhension des mécanismes conduit à un traitement plus efficace
La compréhension de la pathophysiologie de la migraine progresse rapidement. Une meilleure caractérisation et un meilleur diagnostic de ses caractéristiques cliniques ont permis de considérer la migraine comme un dysfonctionnement complexe et variable du système nerveux et pas seulement comme une céphalée vasculaire. Des études récentes ont apporté de nouvelles informations importantes sur ses causes génétiques, ses caractéristiques anatomiques et physiologiques et ses mécanismes pharmacologiques.
L’identification de nouveaux gènes associés à la migraine, la visualisation des régions du cerveau activées dans les premiers stades d’une crise de migraine, une meilleure compréhension du rôle potentiel des nerfs cervicaux et la reconnaissance du rôle crucial des neuropeptides font partie des progrès qui ont conduit à de nouveaux objectifs pour le traitement de la migraine. Le traitement futur de la migraine sera en mesure d’adapter les traitements en fonction des différents mécanismes de la migraine qui affectent les patients individuels, a expliqué le Professeur Andreas Kleinschmidt, directeur de la clinique de neurologie du HUG.
L’orateur a indiqué que les informations actuellement disponibles indiquent une activation du réseau intracrânien qui culmine avec la sensibilisation du système trigémino-vasculaire, la libération de marqueurs inflammatoires et l’initiation d’une réaction inflammatoire méningée perçue comme un mal de tête. La phase postdromique, la moins étudiée, pourrait être le résultat de la poursuite de l’activation du tronc cérébral.
Traitement de la migraine: les trois grands principes
• Suppression des facteurs déclenchants
– Psychologique («stress»)
– Environnement («espace de travail propice à la migraine»)
– Endogène
• Traitement non pharmacologique
• Médication
– Aiguë («rescue»)
– Préventif («prophylaxie»)
Sur le plan thérapeutique, l’acide acétylsalicylique a permis d’éliminer la douleur après 2 heures chez 23.8 % des patients contre 11.5 % sous placebo. Le diclofénac a permis d’atteindre cet objectif dans 24.7 % des cas contre 10.7 % et l’ibuprofène dans 26.2 % des cas contre 12.3 %. Le nerf trijumeau et ses projections sur le système vasculaire intracrânien – le système trigémino-vasculaire – sont au cœur de la migraine. L’identification des mécanismes qui déclenchent des signaux dans ce système a conduit à des traitements ciblés et à des thérapies préventives pour la migraine. Les anticonvulsivants valproate de sodium et topramate ne sont pas autorisés en Suisse pour cette indication. La flunarizine, un bloqueur des canaux calciques, n’est plus commercialisée et l’onabotulinumtoxine A n’est autorisée que pour la migraine chronique.
Médicaments de secours anti-migraineux spécifiques: triptans
Le traitement de la migraine se fait par étapes. Au début, on utilise des analgésiques traditionnels (p. ex. ibuprofène, paracétamol). Au fur et à mesure de l’évolution du traitement, on passe aux triptans et aux géants. Les triptans se lient aux récepteurs de la sérotonine et provoquent une vasoconstriction dans le cerveau, ainsi qu’une réduction de l’inflammation. Ils peuvent être utilisés sous différentes formes, par exemple sous forme de spray nasal pour les personnes souffrant de vomissements pendant la crise de migraine.
Traitement préventif de la migraine
Médicaments classiques (small molecules)
• Antihypertenseurs: bêtabloquants, sartans
• Bloqueurs des canaux calciques: fluranizine
• Anticonvulsivants: topiramate, valproate
• antidépresseurs: amitryptiline, venlafaxin
Anticorps monoclonaux CGRP («Biologic») dans la prévention de la migraine
Ces médicaments ont un début d’action rapide et entraînent peu d’événements indésirables, les plus fréquents étant des réactions au site d’injection telles que l’érythème et la douleur. L’érénumab, le fremanezumab et le galcanezumab se sont également avérés bénéfiques chez les patients qui ne répondent pas aux autres classes de médicaments préventifs. Dans une étude de prolongation ouverte de 5 ans, l’érénumab est resté sûr chez les patients souffrant de migraines épisodiques. L’effet maximal est atteint avec ces médicaments après 24 h.
En cas de traitement par atogépant, les variations par rapport à la valeur initiale sur 12 semaines ont été de –3.7 jours avec 10 mg d’atogépant, –3.9 jours avec 30 mg d’atogépant, –4,2 jours avec 60 mg d’atogépant et –2.5 jours avec un placebo. Les différences moyennes par rapport au placebo en termes de variation par rapport à la valeur initiale étaient de –1.2 jour avec l’atogépant 10 mg (intervalle de confiance à 95 % [IC], –1.8 à –0.6), –1.4 jour avec l’atogépant 30 mg (IC à 95 %, –1.9 à –0.8) et –1.7 jour avec l’atogépant 60 mg (IC à 95 %, –2.3 à –1.2) (P < 0.001 pour toutes les comparaisons avec le placebo).
L’atogépant pris par voie orale une fois par jour a efficacement réduit le nombre de jours de migraine et de céphalées sur une période de 12 semaines. Parmi les événements indésirables figuraient la constipation et les nausées. L’intervenante a présenté un algorithme de traitement pour la prise en charge clinique de la migraine (Ashina M. N Engl J Med 2020).
Le gépant pendant un prodrome – sauvetage ou prophylaxie?
La bonne approche se situe-t-elle entre les deux? Rimegepant offre un bénéfice préventif selon les besoins (Edwinsson et al, CGRP as the target of new migraine therapies – successful translation from bench to clinic. Nature Rev Neurol 2018).
riesen@medinfo-verlag.ch
- Beaucoup de nouveautés dans les médicaments de secours et préventifs
- Pas de miracle
- Approche par essais et erreurs
- Ne pas négliger les options non pharmacologiques
- Rester conscient des coûts – mais aussi des coûts globaux
la gazette médicale
- Vol. 13
- Ausgabe 7
- November 2024