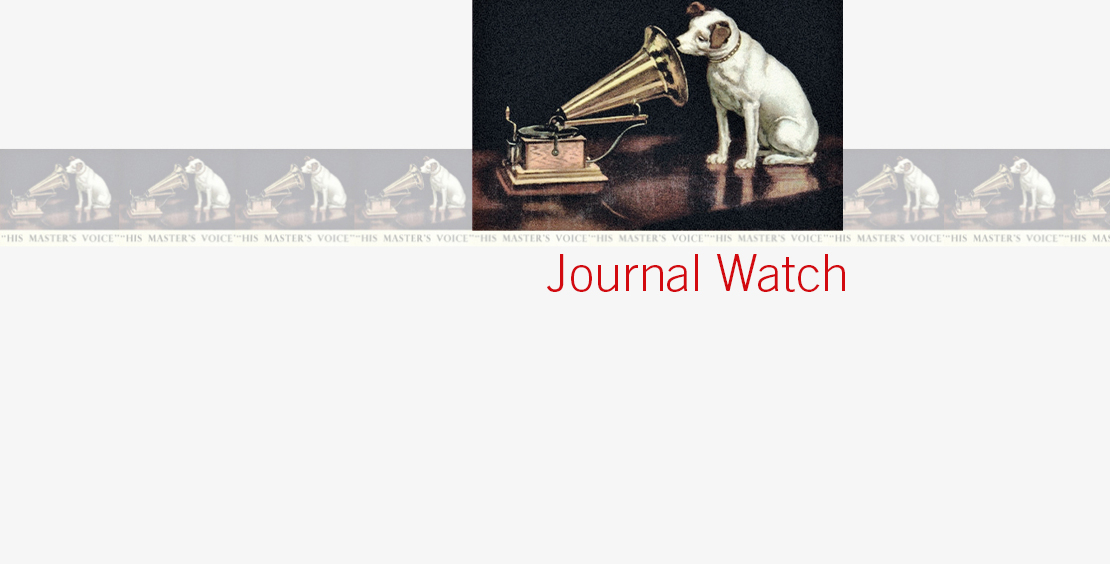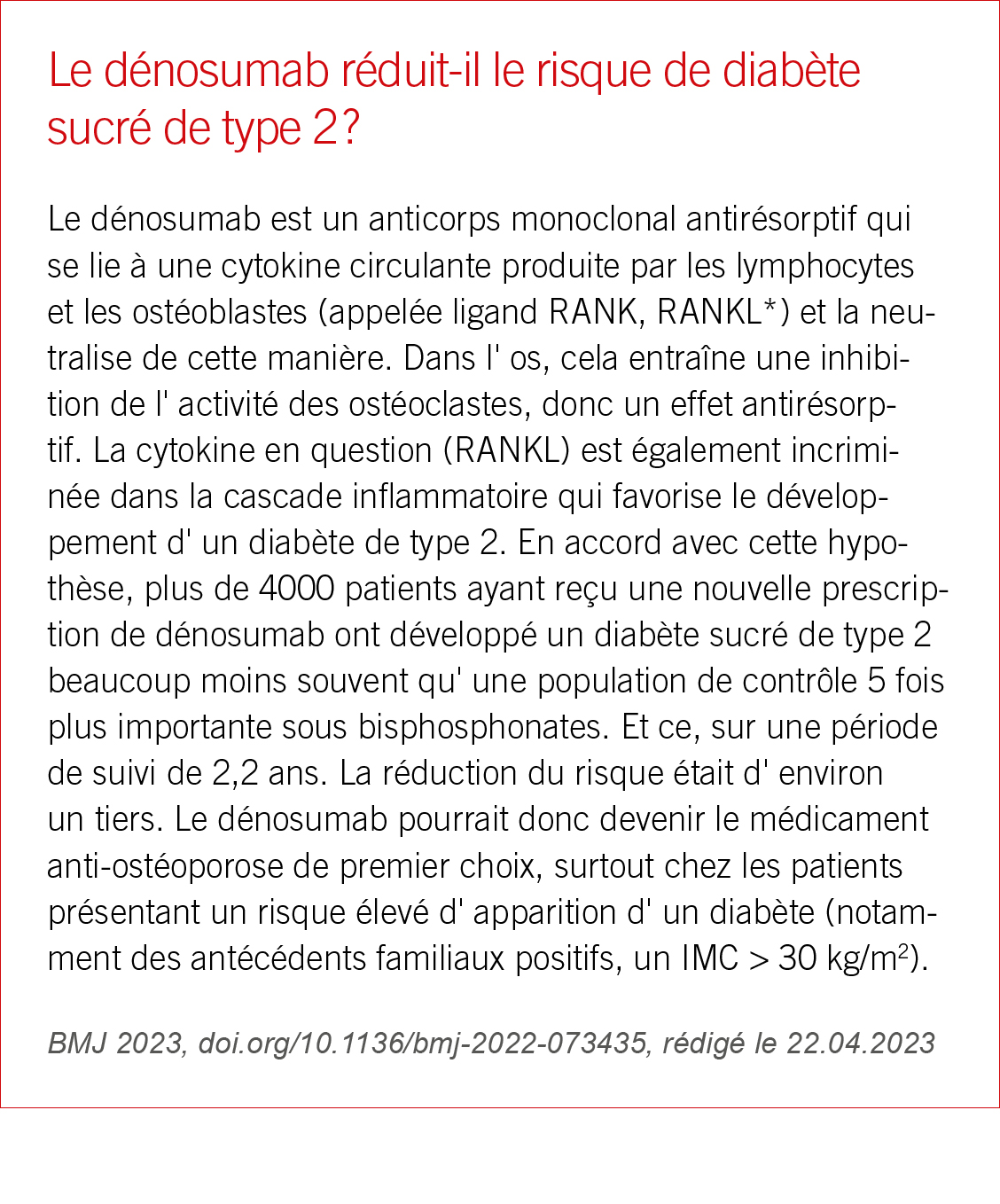- RETO KRAPFs Medical Voice im Juni
Dernières parutions
L’ hibernation des ours sans les conséquences de l’ immobilisation subies par l’ humain

Les ours effectuent une longue hibernation durant laquelle ils sont presque totalement immobilisés. Malgré cela, contrairement aux humains, ils ne développent pas d’ ostéoporose, d’ atrophie musculaire et rarement de thromboembolies. Il est également intéressant de noter que le taux de filtration glomérulaire chute à pratiquement 0 ml/min et que les ours présentent une anurie en hiver. Cependant, ils ne développent pas d’ urémie, alors que la production d’ azote se poursuive en utilisant les réserves estivales. Les ours évitent l’ urémie en sécrétant alternativement de l’ urée et de l’ ammoniaque dans la lumière intestinale (1). Les ours – lorsque leur hibernation est perturbée – conservent également au moins une partie de leur capacité cardiovasculaire et peuvent – contrairement à l’ homme après une immobilisation prolongée – sortir de leur tanière au galop avec une agilité surprenante !
Nous pourrions donc apprendre beaucoup des ours au niveau de prévention et traitement, par exemple en ce qui concerne les effets secondaires liés à l’ immobilisation décrits ci-dessus ! Une étude scandinave montre que les thromboembolies ne sont pas inconnues chez les ours et qu’ ils sont donc tout à fait qualifiés pour servir d’ espèce de comparaison. Mais, pendant l’ hibernation, les ours peuvent inhiber l’ activation des plaquettes sanguines par la suppression de différentes protéines plasmatiques activant les plaquettes, la suppression la plus marquée étant celle de la “heat shock protein 47, HSP47” (2). Cette protéine est également supprimée chez les personnes immobilisées et pourrait donc être un mécanisme de protection, même s’ il n’ est pas efficace à 100% chez l’ homme. Peut-être qu’ un antagoniste de HSP47, en plus ou même comme remplacement (?) de l’ anticoagulation préventive actuellement utilisée, serait une cible d’ intervention intéressante.
1. Kidney International 2012, doi.org/10.1038/ki.2012.396, 2. Science 2023, DOI : 10.1126/science.abo5044, rédigé le 21.04.2023
Thrombectomie endovasculaire jusqu’ à 24 heures et également en cas d’ infarctus cérébral ischémique important
La thrombectomie intravasculaire (par aspiration et/ou stent), réalisée en règle générale dans les 6 heures suivant l’ apparition des premiers symptômes et les infarctus – légers à moyennement importants – permet d’ obtenir un taux de recanalisation d’ environ 75% et une indépendance fonctionnelle significativement plus élevée après 90 jours (avec un « number needed to treat » impressionnant de seulement 2,3 !) Toutefois, la mortalité globale n’ est pas réduite. Il existe maintenant trois études indépendantes (environ 1000 patients en tout, populations japonaise, chinoise et américaine) qui montrent un bénéfice comparable également en cas d’ infarctus cérébral important (volume cérébral ischémique >50 ml) (1,2,3). Les grands infarctus cérébraux avaient été exclus des études précédentes en raison du risque de dommages de reperfusion et d’ hémorragies dans le tissu cérébral nécrosé. En ce qui concerne le moment ou « windows of opportunity », une étude hollandaise montre, chez des patient(e)s ayant subi un accident ischémique (artères cérébrales antérieures), que le bénéfice d’ une meilleure récupération fonctionnelle avec une indépendance fonctionnelle dans les premières 24h après l’ accident est maintenu. Ceci est notamment le cas chez les patients chez lesquels un flux collatéral important (et donc un meilleur approvisionnement des tissus en oxygène) a pu être mis en évidence par tomodensitométrie (4). La fenêtre d’ opportunité pour des interventions réussies s’ est donc significativement élargie et même les grands accidents ischémiques ne sont plus une contre-indication en soi à une thrombectomie endovasculaire.
1. NEJM 2022, DOI : 10.1056/NEJMoa2118191, 2. NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMoa2214403, 3. NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMoa2213379, 4. The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00575-5,
Dernières parutions
Traitement des infections récidivantes à Clostridioides difficile : Sans transplantation de microbiote fécal ?
La plupart des épisodes d’ infection à Clostridioides difficile se traitent bien par antibiotiques. Toutefois, le risque de récidive après une première infection est d’ environ 25%. Chez ces patients, la probabilité d’ autres récidives est de 60% – un chiffre impressionnant. Les directives recommandent donc pour les patients à haut risque de rétablir par des greffes de selles de donneurs sains la composition du microbiote qui joue un rôle protecteur important. Une alternative consiste à utiliser des “biothérapies” qui remplacent les greffes de microbiote non sélectives par des souches bactériennes spécifiques et protectrices (cultivées in vitro). Une telle étude a utilisé 8 souches de Clostridioides commensales, non pathogènes et ne produisant pas de toxines, qui ont été transmises aux patients à haut risque après l’ administration de laxatifs. Ces souches de Clostridioides ont permis de réduire le risque de récidive de plus d’ un tiers (à presque 14% par rapport à près de 46% sous placebo, follow-up = 8 semaines). Ce sont des données impressionnantes ! Si elles sont confirmées, l’ ouverture pour ces biothérapies innovantes est faite. Toutefois, même avec celles-ci, le risque de récidive n’ est pas nul – raison pour laquelle il convient d’ examiner d’ autres mesures ou des compositions alternatives des souches bactériennes.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.4314, rédigé le 21.04.2023
Testez vos connaissances de base du dépistage du cancer de la prostate !
Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?
1. Le dépistage du PSA (prostate specific antigen) permet de réduire légèrement la mortalité – après 13 ans – de 1,3 cas pour 1000 hommes dépistés.
2. Le taux de survie à 10 ans des hommes ayant subi un dépistage par PSA et présentant un cancer de la prostate localisé est de 70%.
3. En cas de résultat positif du dépistage PSA, un examen au scanner CT de la loge prostatique est indiqué.
4. Chez les patients présentant un risque de progression histologique faible à moyen, une surveillance active (tests PSA et biopsies réguliers) est équivalente au traitement d’ éradication initial (radiothérapie ou chirurgie).
Réponse :
Le dépistage du PSA entraîne une légère réduction de la mortalité liée au cancer de la prostate (question 1). Le taux de survie à 10 ans après un dépistage du PSA et un cancer de la prostate localisé est de 95% (question 2). Un examen IRM de la prostate est recommandé pour choisir le meilleur site de biopsie après un dépistage du PSA positif (question 3). Une surveillance active est une alternative très valable aux interventions radiothérapeutiques ou chirurgicales primaires (question 4).
NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMcp2209151, rédigé le 24.04.2023
A noter également
Quel sel pour les personnes âgées ?
Si vous vous occupez de patients dans des maisons de retraite ou de santé, ce travail pourrait vous intéresser : La réduction du sel de cuisine (NaCl) ajouté au repas ou déjà contenu dans des aliments préfabriqués comme le pain peut être obtenue par une réduction progressive de la teneur en sel sans que les personnes concernées ne se plaignent, car les préférences gustatives s’ adaptent manifestement aussi. Dans près de 50 foyers chinois, un remplacement partiel du sel alimentaire (NaCl) par du chlorure de potassium (KCl) a été prescrit aux cuisiniers dans le cadre d’ une étude. Les conséquences étaient comparées à celles en cas de non-intervention ou de réduction seule du NaCl, sur une durée d’ observation de deux ans. Les résultats sont impressionnants et comparables à de nombreuses études menées dans d’ autres populations qui ont démontré un bénéfice de la réduction du sodium accompagnée d’ une augmentation du potassium dans le régime : Un « salage » combiné dans la cuisine à domicile (62,5% NaCl, 25% KCl, le reste en sels organiques) a réduit de manière significative les valeurs de la pression artérielle systolique et diastolique et les événements cardiovasculaires, mais pas la mortalité globale. Une réduction isolée du sel de cuisine ajouté n’ a eu que des effets marginaux. L’ absence d’ effet sur la mortalité (qui, par nature, ne devrait plus être l’ objectif principal dans cette population), mais les effets positifs sur la morbidité sont des arguments forts pour augmenter le potassium au détriment du sodium dans le régime. Les données ont d’ ailleurs été recueillies dans une population avec une consommation assez élevée de sel de cuisine (environ 10 grammes par jour, mesurés par une collecte des urines de 24h).
Nature Medicine 2023, doi.org/10.1038/s41591-023-02286-8, rédigé le 24.04.2023
Physiologie et physiopathologie
Comment agissent les agonistes du GLP-1 ?

Les agonistes du glucagon-like peptide 1 (GLP-1, en particulier le sémaglutide) sont utilisés dans de nombreux pays comme antidiabétiques et pour la réduction du poids (en partie encore « off-label »). C’ est surtout l’ effet important et durable sur le poids corporel qui a ouvert un nouveau chapitre dans le traitement de l’ obésité par rapport aux réductions de poids non chirurgicales pratiquées jusqu’ à présent. C’ est pourquoi il est peut-être bon de vous rappeler, à l’ aide de la figure suivante, les multiples mécanismes d’ action du glucagon-like peptide et donc de ses agonistes.
JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.2438, rédigé le 27.04.2023
Bon à savoir également
Vaccin contre les pneumocoques supplémentaire en Suisse
En plus du Prevenar13 autorisé et pris en charge par les caisses maladie, un nouveau vaccin (Vaxneuvance) a été autorisé par Swissmedic et sera disponible sur le marché et facturé à la charge de l’ AOS aux alentours du 20 avril. L’ autorisation est limitée aux personnes de plus de 65 ans qui présentent un risque accru de contracter des infections invasives (environ 20 pour 100 000 par an). L’ effet protecteur contre les infections invasives à pneumocoques semble significativement meilleur dans cette population en raison des 2 sérotypes supplémentaires contenus dans le vaccin (22F et 33 F) (voir aussi “Connaissances générales”).
Bulletin InfoVac N3, 2023, www.infovac.ch. Rédigé le 06.04.2023
Consultation par téléphone ou par vidéo ?
Ces deux formes de consultation ont de nombreux avantages, surtout si l’ on a vu les patients avant et qu’ on les connaît bien. Mais quel genre de consultation est favorisé par les patients ? Une étude – menée toutefois dans le système de santé américain – arrive à la conclusion que de nombreux patients préfèrent la consultation par téléphone. Il n’ est pas surprenant qu’ il s’ agisse surtout de personnes âgées et économiquement moins privilégiées. Toutefois, les cabinets médicaux, même s’ ils proposent des vidéoconsultations, offrent en premier lieu la consultation téléphonique qui est probablement plus rapide au quotidien !
JAMA network open 2023, doi : 10.1001/jamanetworkopen.2023.5242, rédigé le 06.04.2023
Traitement de l’ orthostatisme en 2030 ?
Les orthostases d’ origine neurologique peuvent être invalidantes. Elles sont liées au vieillissement ou acquises d’ une autre manière (par exemple dans le cas de l’ atrophie multisystémique), mais aussi post-traumatiques (notamment dans le contexte de syndromes médullaires). Les conséquences des chutes entraînent alors des atteintes supplémentaires à la santé. Il existe certes une série de médicaments avec différentes cibles, mais ils ne sont souvent pas suffisamment efficaces. Les neuroprothèses sont également évaluées pour ces indications : Un groupe de chercheurs de l’ EPFL à Lausanne a développé un système sous licence industrielle (1, 2), dans lequel une série d’ électrodes est implantée dans la moelle épinière et activée par un générateur d’ impulsions également implantable. Il est ainsi possible d’ activer le baroréflexe et de limiter, voire d’ empêcher l’ orthostatisme. Une approche prometteuse, même si elle est coûteuse !
1. NEJM 2022, doi:10.1056/NEJMoa2112809, 2. Science 2023, doi/10.1126/science.adg7669, rédigé le 06.04.2023
Le café n’ est pas associé à plus d’ extrasystoles auriculaires
En médecine, la consommation de café contenant de la caféine a une histoire très mouvementée vu d’ un côté les avantages présumés et de l’ autre son association avec des risques pour la santé. Dans la référence 1, les lecteurs trouveront un bon résumé critique et actuel des effets biologiques de la caféine chez l’ homme (1). En ce qui concerne les extrasystoles auriculaires (précurseurs de la fibrillation auriculaire), l’ alerte peut être levée. Dans une population générale de 100 volontaires âgés d’ à peine 40 ans, composée d’ autant d’ hommes que de femmes, aucun effet de la consommation de café contenant de la caféine sur le nombre d’ extrasystoles auriculaires n’ a pu être constaté de manière prospective et randomisée (2). Le point positif de l’ étude est qu’ elle a été réalisée en cross-over, ce qui a permis d’ étudier chaque individu dans une période avec et sans caféine. Les auteurs et les éditeurs du New England Journal of Medicine obtiennent une moins bonne note pour le choix du titre du travail : il avait été annoncé que l’ étude avait examiné les effets aigus du café sur la santé. Mais le critère d’ évaluation primaire était alors très modeste, à savoir “seulement” le nombre d’ extrasystoles auriculaires.
1. NEJM 2020, doi:10.1056/NEJMra1816604, 2. NEJM 2023, doi:10.10565/NEJMoa2204737, rédigé le 27.03.2023
krapf@medinfo-verlag.ch